Condamné sans savoir ? La Cour trace les limites du recours tardif

Par son arrêt n° 55/2025 du 3 avril 2025, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur la question préjudicielle posée par le Tribunal de police d’Anvers, portant sur une éventuelle discrimination résultant de l’article 65/1, § 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. La question centrale était de savoir si le fait d'imposer au contrevenant la preuve qu’il n’a pas pu prendre connaissance d’un ordre de paiement constituait une violation du droit à l’égalité et à un procès équitable.
Le contexte : l’ordre de paiement dans la procédure pénale routière
Introduit par la loi-programme du 25 décembre 2016, l’ordre de paiement vise à alléger la charge des tribunaux en matière d’infractions routières. Il s’agit d’un mécanisme administratif par lequel le ministère public peut imposer une amende sans intervention judiciaire, après plusieurs rappels et une proposition de transaction ignorés par le contrevenant.
Ce dernier peut introduire un recours dans les 30 jours suivant la notification. S’il démontre ne pas avoir pu en prendre connaissance à temps, un délai supplémentaire de 15 jours lui est accordé (article 65/1, § 8). Toutefois, cette preuve incombe au contrevenant.
La question préjudicielle : traitement inégal et charge de la preuve
Le Tribunal de police d’Anvers a comparé ce régime à celui prévu à l’article 187, § 1er, du Code d’instruction criminelle, relatif à l’opposition contre un jugement par défaut. Dans ce dernier cas, le condamné peut introduire une opposition sans devoir prouver qu’il ignorait la signification du jugement, dès lors qu’il n’en a pas eu personnellement connaissance.
Le juge a quo estime que cette différence de traitement, dans deux procédures ayant toutes deux pour effet une condamnation définitive, pourrait constituer une atteinte au principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) et au droit d’accès à un juge (article 6 CEDH).
La réponse de la Cour : une différence de traitement justifiée
La Cour relève que les deux procédures comparées ne s’inscrivent pas dans le même cadre : l’ordre de paiement ne relève pas d’une procédure judiciaire stricto sensu. Elle met aussi en lumière le fait qu’il s’agit du cinquième rappel adressé au contrevenant, et que celui-ci a donc eu plusieurs occasions de s’acquitter volontairement de l’amende.
Elle insiste sur le fait que l’ordre est notifié par pli recommandé ou via des canaux judiciaires, et que la charge probatoire imposée au contrevenant — certes sur un fait négatif — ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour estime par conséquent que l’article 65/1, § 8, ne viole ni les articles 10 et 11 de la Constitution ni l’article 6 de la CEDH.
Une décision qui conforte l’administration, mais interroge
Si la décision de la Cour se veut pragmatique en valorisant l’efficacité de la procédure administrative, elle soulève néanmoins des questions en pratique. La preuve de la non-connaissance d’un envoi recommandé reste souvent difficile à établir pour le citoyen, surtout en cas d’absence prolongée, de déménagement ou de dysfonctionnement postal. Le risque de condamnation par inertie demeure, même lorsque la volonté de fraude ou de désintérêt n’est pas avérée.
Cette jurisprudence conforte l’architecture administrative du traitement des infractions routières, mais impose aux praticiens du droit une vigilance accrue dans l’accompagnement des clients confrontés à ces procédures — notamment en matière de preuve à réunir pour justifier un recours hors délai.
Nos premiers conseils sont gratuits
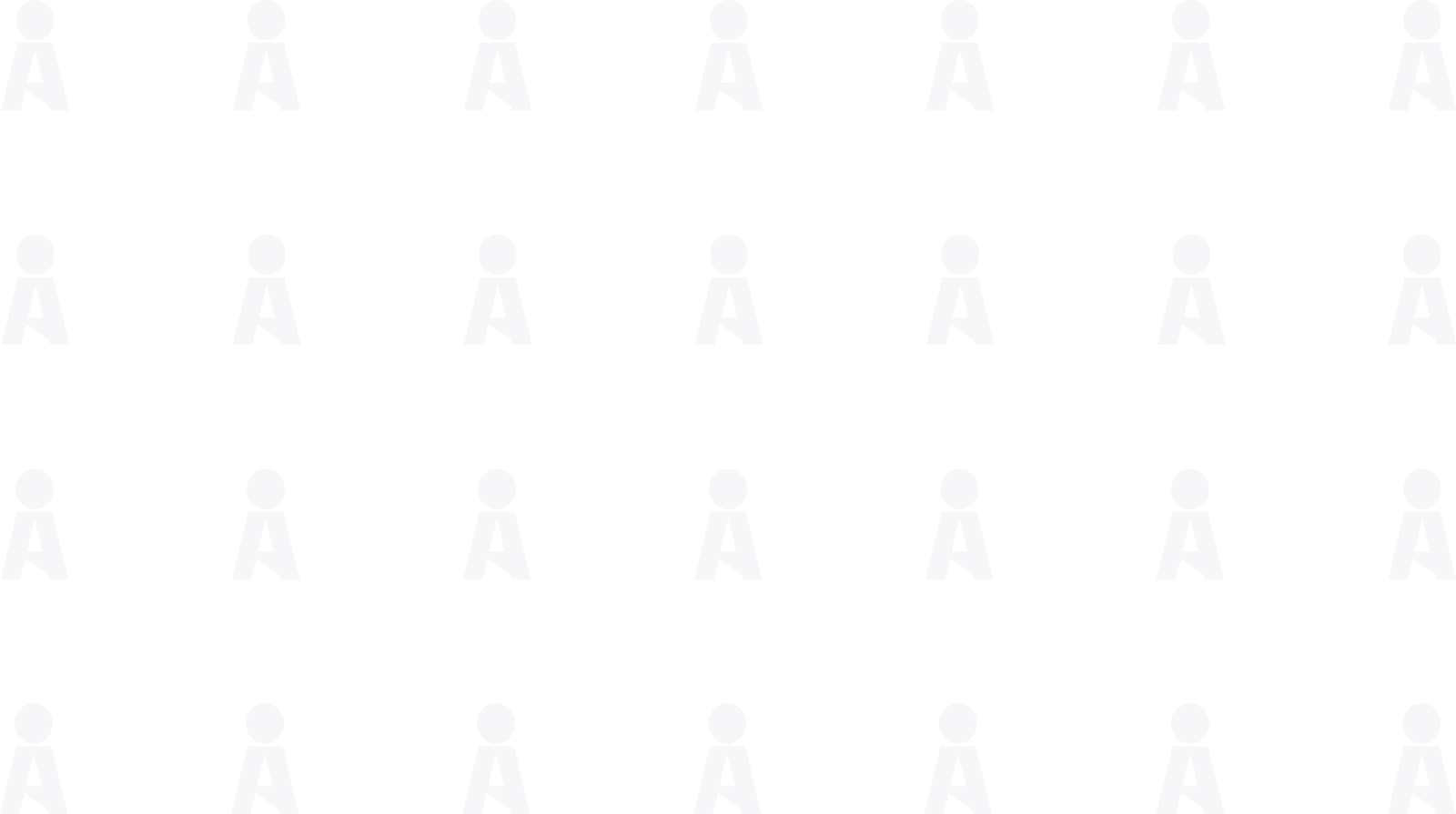
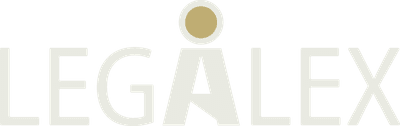

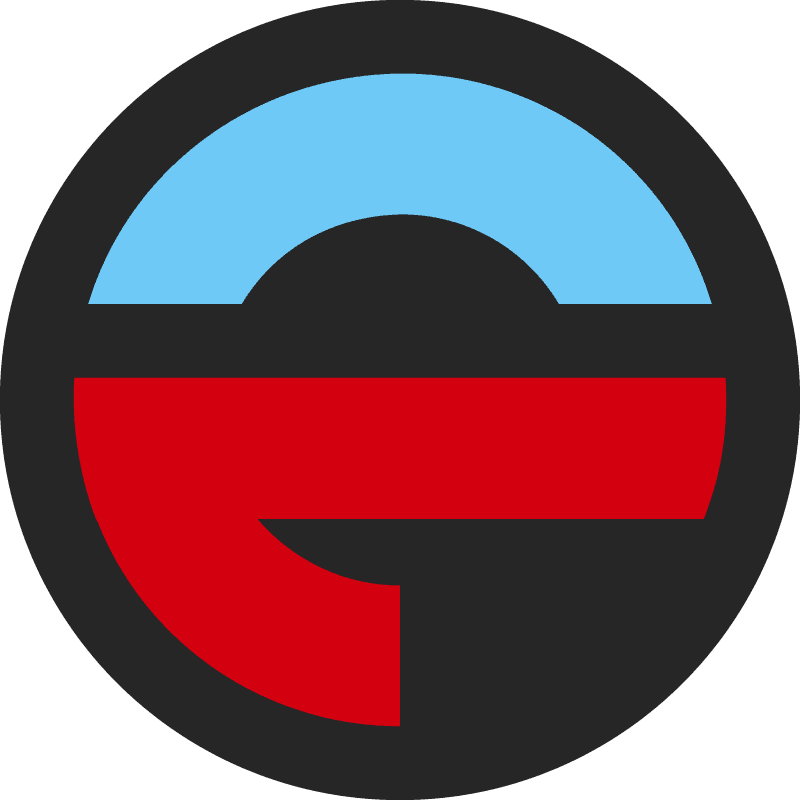 Codelaw
Codelaw